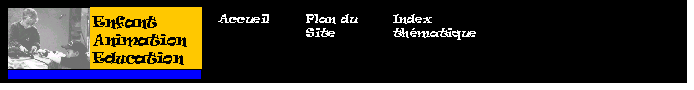

|
Les règles de vie en centre de vacances |
|
|
...
Ce centre de vacances à dominante poney accueillait en juillet 1993 vingt enfants de 9 à 13 ans. L'équipe était composée d'un directeur et de deux animateurs. Pour le poney, 3 animatrices équitation intervenaient. J'avais préparé avec eux avant le séjour afin que l'activité s'intègre à notre projet.
L'un de nos objectifs était de permettre aux enfants de vivre une certaine autonomie. Pour l'atteindre, un travail autour des règles de vie nous a paru être un bon moyen. Ces règles définissent un cadre qui permet à l'enfant de savoir ce qu'il peut faire et ce qui lui est interdit.
|
L'autonomie, c'est aussi construire des règles |
Au cours de la préparation du séjour, l'équipe a réfléchi autour de plusieurs questions :
![]() Qui pose les règles ?
Qui pose les règles ?
Il nous a semblé important que l'équipe donne les premières règles pour donner un repère aux enfants, leur permettant, dés le début du séjour, de vivre ensemble et d'agir.
En même temps, on ne connaît pas les enfants, leurs habitudes, leur maîtrise de l'autonomie. Définir toutes les règles avant le séjour serait en contradiction avec notre objectif. L'autonomie, c'est aussi construire des règles de vie.
Nous décidons de poser quelques règles et de donner aux enfants le droit de les contester, de les modifier. Cela passera par la négociation entre les enfants et avec les adultes.
|
Les devoirs sont faits pour protéger ses droits |
![]() Comment les règles seront
définies ?
Comment les règles seront
définies ?
Deux points sont non-négociables et expliciter aux enfants.
1.Le respect de la loi républicaine. On ne se mettra pas hors-la-loi. Mais on vérifiera toujours si ce que l'on interdit à priori est bien inscrit dans la loi. (Par exemple, la loi n'interdit pas aux enfants de sortir seul du centre.)
2.Le refus de la violence sous toutes ses formes (physiques, verbales, affectives, exclusion...) et de qui que se soit (enfants comme adultes).
Il nous faudra aussi tenir compte des exigences de la structure (ne pas déplacer les lits par exemples).
Tout le reste est négociable. C'est au cours de réunions réunissant les enfants et l'équipe d'encadrement que seront négociés les modifications ou les nouvelles règles. Ces réunions auront lieu au moins tous les deux ou trois jours.
![]() Comment les règles seront
exprimées ?
Comment les règles seront
exprimées ?
Nous pensons que la forme a beaucoup d'importance. Les règles étaient formulées sur le modèle " je peux... je dois... " Par exemple, " je peux emprunter un livre, je dois le ranger quand j'ai fini de le lire. " Nous voulions ainsi faire prendre conscience qu'un individu a des droits mais aussi des devoirs. Et que ces devoirs ne sont pas faits pour les embêter, mais pour protéger leurs droits. Si je ne range pas un livre, les autres ne pourront pas le lire ; si les autres ne rangent pas un livre, je ne pourrais pas le lire.
|
|
|
La règle donne la possibilité d'agir |
Nous allons maintenant voir à travers quatre moments du séjour comment ce travail autour des règles de vie a permis un apprentissage d'une citoyenneté active, parce que construite avec les enfants.
![]() Le non-respect d'un devoir entraîne la
suppression du droit associé.
Le non-respect d'un devoir entraîne la
suppression du droit associé.
Les jeux de société mis à disposition des enfants ne sont pas rangés. J'en fais la remarque lors de la réunion enfants-adultes et je rappelle la règle : " Je peux emprunter un jeu de société, je le range lorsque j'ai fini d'y jouer ". Unanimement, les enfants promettent de faire attention.
Le lendemain, les jeux ne sont toujours pas rangés. L'équipe décide alors de changer la règle qui devient " Si je veux emprunter un jeu, je le demande à un animateur. "
Les enfants acceptent. Pourtant, ils s'aperçoivent vite que cette règle limite leurs possibilités d'agir. Il leur faut maintenant trouver un animateur ; celui-ci n'est pas forcément disponible... Le lendemain, les enfants proposent de revenir à l'ancienne règle, en y ajoutant la nomination de volontaires chargés avant chaque repas de vérifier si les jeux sont bien rangés.
Les enfants ont pris conscience de l'intérêt de la règle. C'est elle qui leur donne ou non la possibilité d'agir. En acceptant leur légère modification, nous leur avons permis de se l'approprier plus facilement.
|
Construire une règles, apprendre à négocier |
![]() Quand les enfants proposent un nouveau droit.
Quand les enfants proposent un nouveau droit.
Au début du séjour, la règle était " je peux sortir du centre avec un animateur ". Au bout d'une semaine, trois filles viennent me voir et me demande pourquoi elles n'ont pas le droit de sortir seules. Je leur propose d'en discuter à la réunion de ce soir.
La proposition des filles est acclamée par les autres enfants. Un nous rappelle que les parents ont signé une autorisation et que nous ne pouvons les en empêcher. J'interviens pour leur dire que, même si leurs parents ont signé, je reste, en tant que directeur, responsable d'eux pendant le séjour. Par contre, je suis prêt à accepter leur demande, mais il faut négocier les conditions.
Après discussion entre les enfants et les animateurs, la règle devient " je peux sortir du centre, avec au moins un autre enfant et après autorisation d'un adulte. Je dois dire où je vais, avec qui, pour quoi faire et respecter l'heure du retour défini avec l'adulte ".
Les enfants ont appris à construire une règle, en acceptant les contraintes, en apprenant à négocier. Ils ont compris que les adultes étaient prêts à écouter leurs demandes et à en tenir compte, sans renier leurs responsabilités.
|
Préserver son intimité en vivant en collectivité |
![]() Quand un problème se pose, on cherche
une nouvelle règle.
Quand un problème se pose, on cherche
une nouvelle règle.
Les enfants sont hébergés dans des chambres de 3 à 6 lits. Ils ont la possibilité dans leur chambre dans la journée à la condition de rester calme. Les enfants s'occupaient du rangement et du nettoyage. Libre à eux de s'organiser, avec l'aide éventuellement d'un animateur.
Le troisième jour, un problème se pose. Léo et Jérôme viennent trouver l'animatrice. Ils en ont assez que les filles viennent trouver Christophe dans leur chambre. Elles s'assoient sur leur lit, ne font pas attention à leurs affaires, salissent la moquette... Et, rajoute Jérôme, les filles n'ont rien à faire dans une chambre de garçons ! L'animatrice leur donne raison et demande aux filles de sortir. Passant par là, j'écoute les plaintes des filles et de Christophe. J'attends la réunion du soir pour soulever le problème. Je trouve normal que les filles désirent venir discuter avec Christophe mais les revendications des deux autres garçons me paraissent également légitimes. La réunion est houleuse. Après trois quarts d'heure d'échanges, et alors qu'aucune solution n'est trouvée, l'équipe décide d'en rester là pour ce soir et propose un nouveau rendez-vous pour le lendemain.
Le lendemain soir, c'est Carole, une habituée de la chambre des garçons, qui propose une règle : " On peut aller dans la chambre des autres si on y est invité par un locataire. On ne s'assoit pas sur les lits des autres, on ne touche pas aux affaires et, si on salit, on nettoie. "
Tout le monde est d'accord, sauf Jérôme. " Je ne vais pas dans la chambre des filles, les filles ne doivent pas aller dans ma chambre. " Les autres enfants déclarent la règle adoptée puisqu'ils sont majoritaires. Je refuse que la majorité impose son choix à un individu. On rediscute, et c'est Léo qui trouvera un compromis acceptable par chacun : " On a le droit d'aller dans les chambres des autres si on y est invité et si les locataires présents sont d'accord. "
Les enfants ont appris à écouter les avis des autres et à en tenir compte. Ils ont aussi vu la difficulté de trouver un compromis, d'accepter que chacun ait sa place. Ils ont pu aussi réfléchir à la notion de démocratie, qui ne se limite pas à " la majorité a raison ".
|
Une même loi pour tous |
![]() Peut-on faire une loi spécifique pour un
enfant ?
Peut-on faire une loi spécifique pour un
enfant ?
Christophe, 12 ans, s'est fait remarquer dés le début du séjour. Il a refusé de faire du poney. Il n'en avait pas envi et n'aimait pas ces animaux. Je lui ai demandé pourquoi il s'était inscrit dans ce centre à dominante. Il m'a répondu : " c'est ma mère et mon éduc' qui m'ont mis ici pour se débarrasser de moi... "
Ce soir, Christophe refuse d'aller se coucher. Il n'est pas fatigué. Je lui demande d'aller quand même dans sa chambre pour lire ou écouter son walkman. Une heure après, Léo vient nous prévenir que Christophe est sorti par la fenêtre et qu'il n'est pas revenu. On le cherche et on finit par le trouver dans la chambre de la fille du propriétaire du centre, avec qui il flirte depuis deux jours. Je dis à Christophe que je n'accepte pas et il retourne se coucher.
Le lendemain soir, Christophe fugue de nouveau. Cette fois, l'équipe le rencontre. Nous lui expliquons que nous ne pouvons pas accepter ces fugues et que nous allons prévenir sa mère. Christophe refuse la règle. Comme il ne fait pas d'équitation, il peut se lever tard le matin et donc ne pas se coucher à 22h30. En fait, il nous demande une règle spécifique pour lui. Je dis à Christophe que l'équipe va réfléchir. Il accepte de ne plus fuguer jusqu'à notre décision.
Le soir, nous réfléchissons à la demande de Christophe. Nous savons qu'il est suivi par un éducateur spécialisé. Nous n'en connaissons pas les raisons, mais nous nous doutons qu'il a un rapport particulier à la loi. Jusqu'à ce jour, nous l'avons accepté tel qu'il est. Il n'a pas fait d'équitation du séjour mais a visiblement passé de bonnes vacances. Il s'est bien intégré au groupe, même s'il lui arrive de le quitter pour rejoindre sa copine.
Dans l'équipe, les avis sont partagés. Doit-on accepter sa demande ? Il est vrai qu'elle est argumentée et qu'elle rentre dans notre logique d'adapter le centre à chaque enfant. Nous connaissons maintenant bien Christophe, et on peut, malgré ces deux fugues, lui faire confiance.
Pourtant, j'ai refusé de consentir à sa demande. L'accepter, c'était dire que la loi n'était pas la même pour tous. En lui reconnaissant un statut particulier, c'était en quelque sorte l'exclure du groupe. Cela pouvait aussi renforcer sa logique de se mettre hors-la-loi.
J'ai expliqué à Christophe les raisons de notre refus. Il a dit les comprendre, bien que cela ne l'ait pas empêcher de fuguer de nouveau le dernier soir. Avant de quitter le centre, il nous a appris qu'il irait prochainement dans un foyer.
|
Savoir poser des interdits |
Christophe nous a montré les limites de notre travail. Si pour les autres enfants, il leur a permis d'apprendre à vivre une citoyenneté active, Christophe n'avait certainement pas les repères suffisants pour entrer complètement dans notre démarche.
On ne peut pas dire pour autant que ce fût un échec complet. Il a eu en face de lui des adultes qui ont assumé leur rôle : lui poser, quand c'était nécessaire, des interdits. Christophe a pu aussi vivre dans une collectivité en acceptant certaines de ses contraintes.
Pour aller plus loin, il aurait fallut travailler avec lui son rapport à la loi. Mais le séjour ne durait que quinze jours. Et l'équipe avait-elle les compétences pour le faire ?
Ce texte a été publié dans la revue des CEMEA " Les Cahiers de l'Animations Vacances-Loisirs " N°19 juillet 1997 sous le titre "l'enfant face à la règle"
|
|
Accueil >> Les enfants, les jeunes >> L'enfant acteur
|
|
|
Enfant Animation Education Http://www.animation.free.fr - juillet 2000 |

